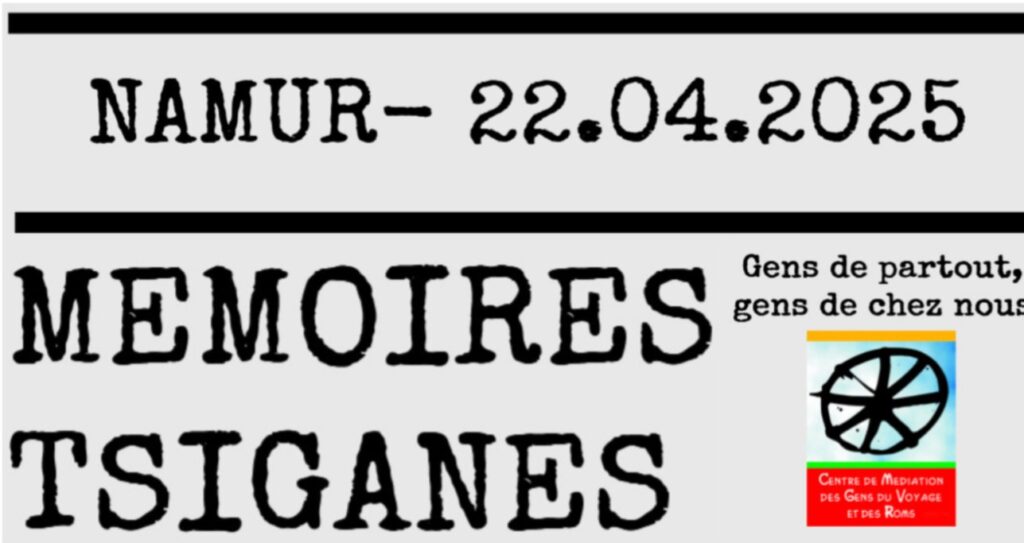Retour sur la conférence du 22 avril 2025
Le génocide tsigane a coûté la vie à près d’un demi-million de personnes sous le régime nazi. Pourtant, ce crime contre l’humanité reste largement méconnu et peu enseigné.
En cette année qui marque le 80ème anniversaire de la victoire sur le nazisme, il est particulièrement important de se souvenir des atrocités commises contre les Gens du voyage. En effet, alors que l’antitsiganisme persiste en Europe, les Gens du voyage continuent de se battre pour leur droit à vivre selon leur mode de vie mobile.
Cette conférence fut l’occasion de découvrir une partie souvent négligée de notre histoire commune. Les différents intervenants ont permis de situer le génocide tsigane dans une perspective historique en explorant les mécanismes qui ont permis sa réalisation et en examinant ses réalités actuelles.
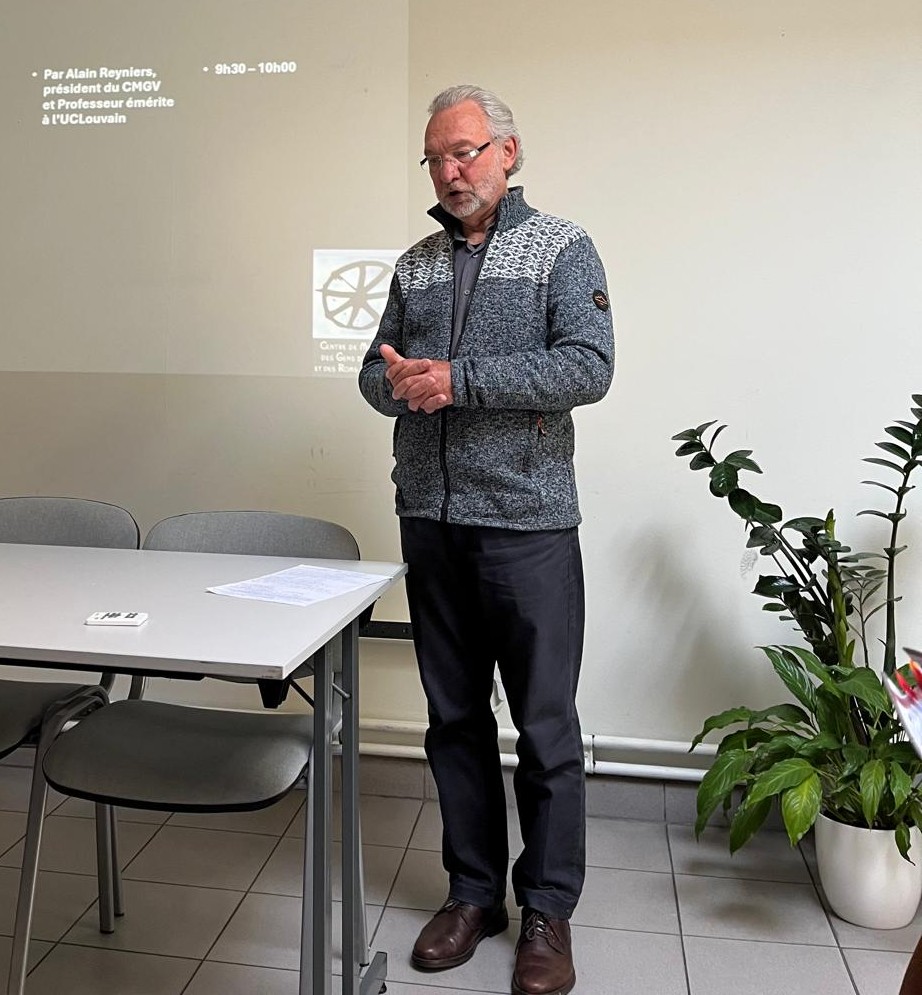
En guise d’introduction à cette journée de conférence, Alain Reyniers, Président du CMGV et Professeur émérite à l’UCLouvain, nous a rappelé les pratiques d’exclusion, de persécutions et de contrôle qui persistent depuis des siècles à l’encontre des Gens du voyage partout en Europe. Si ces persécutions ont évidemment atteint leur paroxysme pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la déportation et l’extermination de 500 à 650 000 personnes – soit près d’un tiers de la population tsigane de l’époque – elles ne sont pas la seule responsabilité des Allemands. En effet, les politiques de sédentarisation forcée et de contrôle administratif mises en oeuvre par différents pays européens dès la fin du XIXème siècle contribue à la marginalisation, l’identification et l’internement des populations roms, manouches et yéniches.
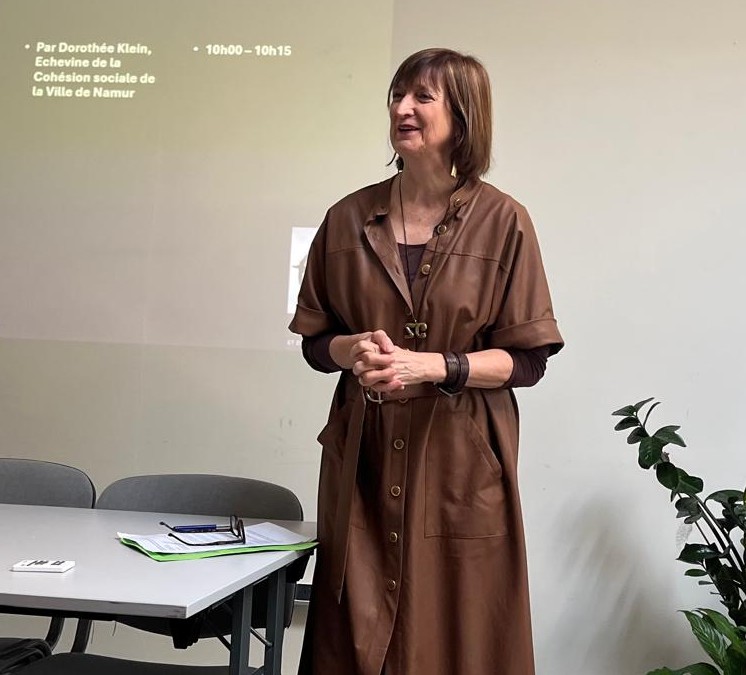

Le passé n’est pas clos : il se prolonge dans le présent par des pratiques d’exclusion systémique.
Monsieur Charpentier nous partage sa fierté d’être Tsigane et d’appartenir à une communauté qui trouve sa force dans la culture – la musique notamment – et la solidarité. Dès lors, il lance un appel au dialogue et à la rencontre. Le peuple tsigane demande peu: être reconnu comme citoyen à part entière, un espace pour leurs caravanes, être accueilli sans suspicion ni peur.

Françoise Tulkens nous a présenté le travail du Groupe des Sages du Sénat dont elle est présidente et qui met en lumière la responsabilité de la SNCB dans les déportations raciales au cours de la Seconde Guerre mondiale. Le Groupe des Sages tente de tirer des enseignements et propose des recommandations pour
(1) établir et faire connaître la vérité,
(2) la transmettre, et
(3) envisager des formes de réparation.
Dans le volet vérité, Madame Tulkens estime qu’il faut informer et former le personnel administratif et politique à réagir face aux dilemmes moraux pour faire en sorte que de telles dérives ne se reproduisent plus.
En ce qui concerne la transmission et la réparation, Madame Tulkens explique que le Groupe des Sages prône une justice restaurative tournée vers l’avenir et à instiller une culture du respect et du dialogue. La reconnaissance de ces faits, leur visibilité et la transmission de cette mémoire sont essentielles pour lutter contre les traumatismes qui continuent à affecter ces communautés. S’agissant des réparations envers la communauté tsigane, Madame Tulkens mentionne notamment la mise à disposition par la SNCB de terrains pour l’accueil des Gens du voyage.

William Acker, délégué général de l’Association nationale des Gens du voyage citoyens, était présent en ligne pour nous présenter l’important travail de cartographie qu’il a réalisé afin de révéler les logiques excluantes qui se révèlent dans le choix de localisation des aires d’accueil.
Pour Monsieur Acker, les pratiques discriminatoires dont sont victimes les Gens du voyage ne sont que la continuité des persécutions raciales subies lors de la Seconde Guerre mondiale. Cela se reflète notamment dans la localisation de certaines aires d’accueil, implantées directement sur des anciens camps d’internement comme c’est par exemple le cas à Angoulême.
Suite à un empêchement de dernière minute, Eli Modest, pasteur au sein de la Mission évangélique tsigane, n’a malheureusement pas pu être présent. Il a néanmoins tenu à nous transmettre un message par l’intermédiaire de Thomas Desai, chargé de mission au CMGV.
Tout comme Monsieur Charpentier, Eli Modest nous rappelle que l’exclusion et la marginalisation des Gens du voyage est loin d’être uniquement un fait historique. Il constate que les récits de ses aînés trouvent aujourd’hui une inquiétante résonance dans l’actualité. Il craint une répétition des mécanismes de marginalisation déjà à l’œuvre avant et pendant le génocide nazi. Il est donc crucial de considérer ces problématiques comme actuelles et non strictement historiques.
Il appelle à briser le silence, à faire entrer cette mémoire dans l’espace public belge tout en à reconnaissant aussi les formes contemporaines de discrimination.
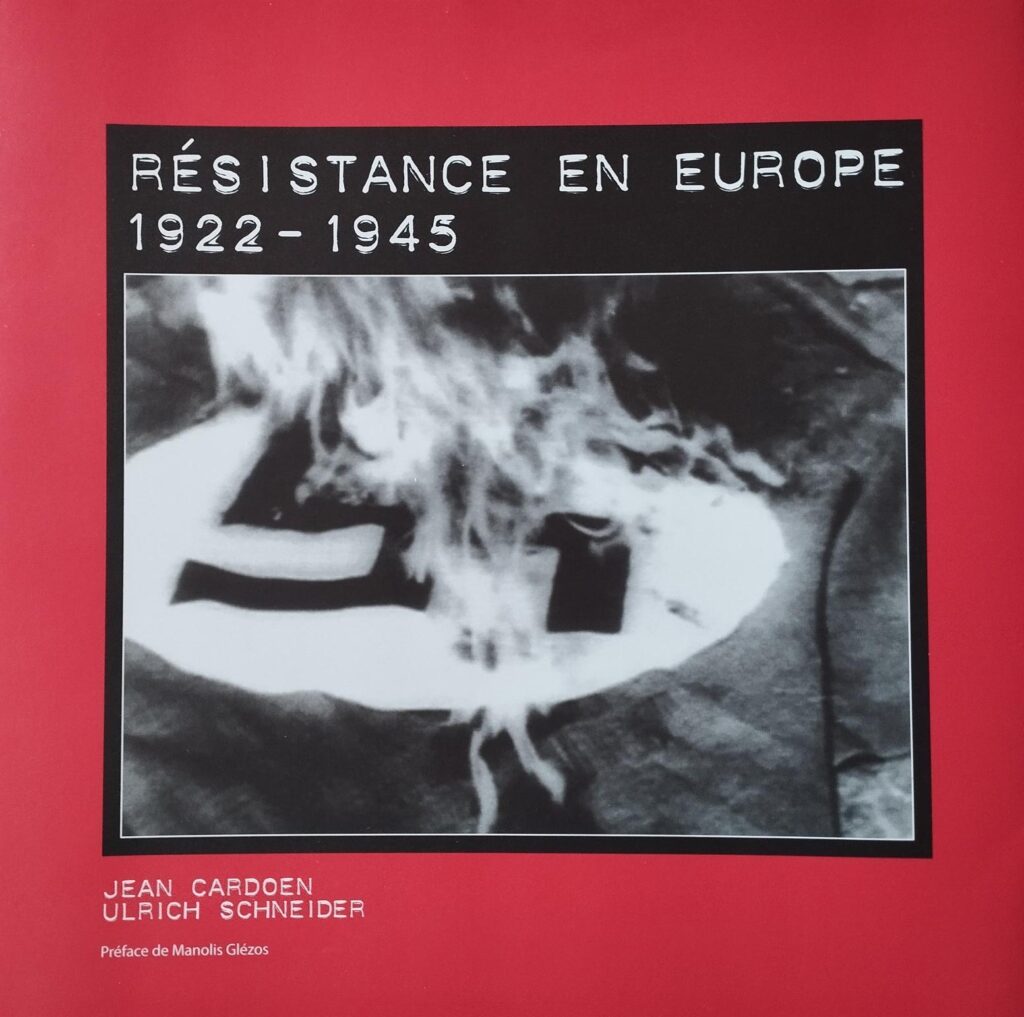
Jean Cardoen, directeur du département préservation et transmission de la mémoire au War Heritage Institute nous a présenté le travail éducatif et mémoriel réalisé par l’Institut.
Dans ce cadre, il a réalisé une carte détaillée répertoriant plus de 2000 camps du système concentrationnaire nazi. Ce projet, initié à partir d’une ancienne carte manuscrite et enrichi par de multiples sources croisées, vise à donner une représentation à la fois scientifique et pédagogique de l’étendue du système concentrationnaire et notamment la déportation des Tsiganes dans des camps spécifiques appelés « Zigeunerlager ».
Jean Cardoen nous rappelle également que dans les camps, chaque détenu était identifié par un symbole: l’étoile jaune pour les Juifs, le triangle rouge pour les opposants politiques, le triangle marron pour les Tsiganes, le triangle rose pour les homosexuels, le triangle vert pour les prisonniers de droit commun, etc. Cette catégorisation souligne l’universalité de la persécution nazie et nous rappelle que nous devons tous nous sentir concernés par la résurgences des extrémismes et être vigilants face aux discours visant à la marginalisation d’une population.

Tatiana Sîrbu, docteure en histoire et collaboratrice scientifique à l’UCLouvain, a enchaîné en nous éclairant sur l’histoire des Roms en Roumanie, Moldavie et en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus particulièrement, ses recherches se sont portées sur la Bessarabie et la Transnistrie, territoires qui ont connu de fréquents changements de frontières et de régimes politiques au cours de la première moitié du XXe siècle, ce qui rend toute recherche historique particulièrement complexe.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le territoire entre les rivières Nistru et Bug est appelé Transnistrie et devient une zone d’administration civile roumaine (1941-1944) dirigée par un gouverneur civil, Gheorghe Alexianu, nommé par le maréchal Ion Antonescu, allié de l’Allemagne nazie. Les Roms y sont déportés massivement alors que d’autres sont condamnés au travail forcé. Les convois de déportés vont marquer les esprits. Les Roms sont forcés à se déplacer à pied, dans des convois parcourant de longues distances et dans des conditions brutales, causant de nombreux décès. Lors de ses recherches sur le terrain, Tatiana Sîrbu a pu retrouver des archives et des témoignages qui montrent que les arrestations étaient brutales et arbitraires et basées sur des dénonciations locales, ce qui témoigne de l’anti-tsiganisme de l’époque.
Aujourd’hui, dans ces territoires de la déportation, un important et urgent travail de recueil de récits de vie reste inaccompli avec les survivants et les témoins qui sont encore en vie ou leur descendants directs. Tatiana Sîrbu insiste sur l’importance de ce travail de terrain pour rassembler archives et témoignages oraux des survivants ou descendants afin de reconstituer les trajectoires de familles déportées, parfois aussi soumises à la sédentarisation forcée sous le régime soviétique après-guerre. Malgré la reconnaissance officielle de l’Holocauste en Roumanie et en Moldavie ces dernières années ainsi que la présence de certains leaders Roms sur la scène politique et dans les milieux universitaires, un important travail de mémoire, de transmission et de commémoration reste encore à faire.

Pour conclure cette journée, Ahmed Ahkim, directeur du CMGV revient sur les évolutions qu’il a pu observer ses 25 dernière années. Il constate que malgré des avancées juridiques et quelques condamnations exemplaires, les discriminations et violences contre les Gens du voyage restent régulières et souvent minimisées.
Il évoque notamment des attaques violentes en période électorale, le refus persistant d’accorder des permis pour l’habitat en caravane, et une administration qui, bien qu’ayant abandonné officiellement le « carnet nomade », perpétue dans les faits des pratiques inégalitaires vis à vis des « habitants de roulottes ».
Cette persistance d’un traitement différencié alimente l’inquiétude quant à la résurgence d’attitudes d’exclusion.
Il conclue cette journée en paraphrasant l’historienne Henriette Asséo: Si on comprend bien que l’extermination des Tsiganes prend sa source dans cet appareillage administratif, civil et social, ce développement d’un régime de contrôle, avant même la mise en place d’un régime totalitaire, on comprend mieux qu’il puisse être reproductible à l’heure actuelle en Europe.